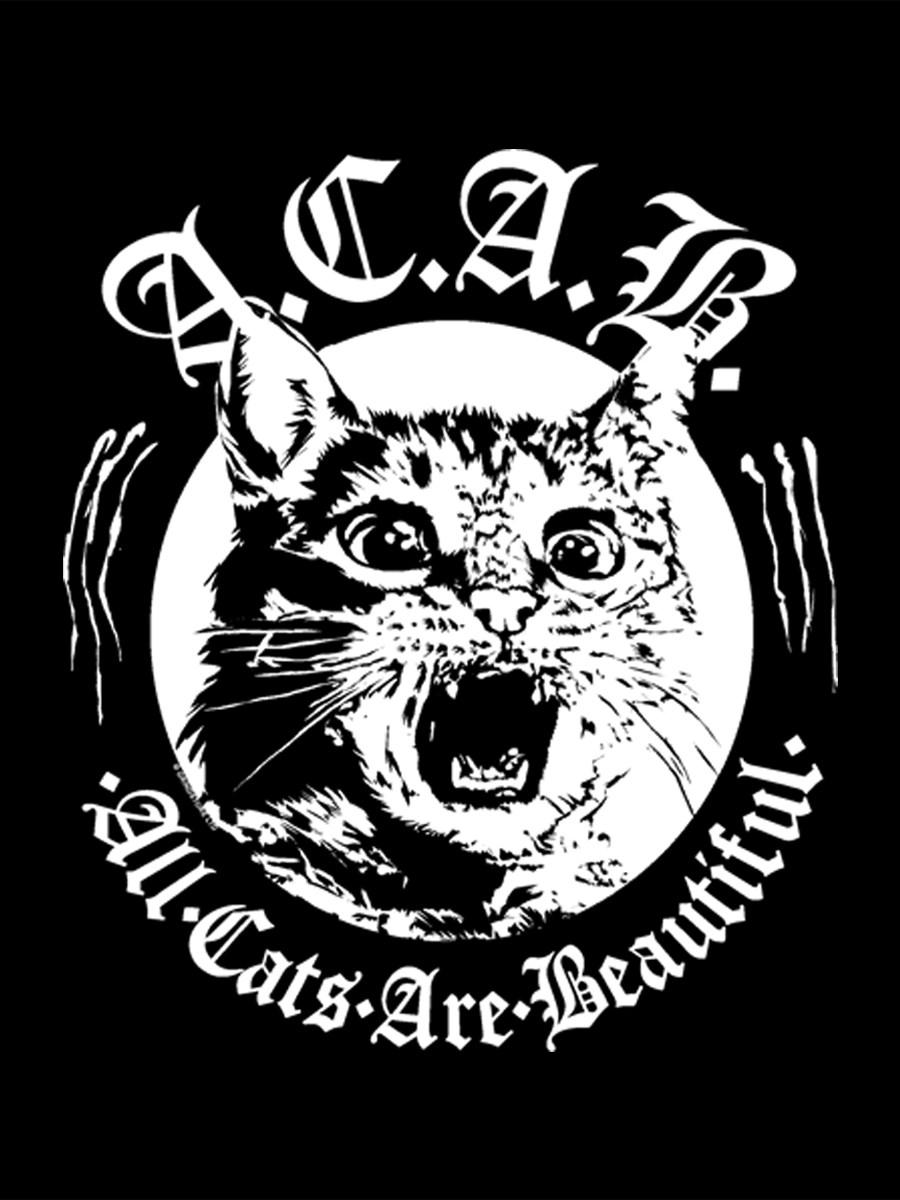En automne 2023, deux campagnes génocidaires et coloniales se sont intensifiées quasiment en même temps : à peine achevé le nettoyage ethnique de l’Artsakh vidé par l’Etat azerbaïdjanais de ses habitant-es arménien-nes, Israël a repris le bombardement de la bande de Gaza, décidant cette fois-ci de rendre inhabitable l’ensemble des terres palestiniennes.
Ces deux catastrophes faisaient directement écho à des tragédies historiques revenant hanter les survivant-es et leurs descendant-es : le génocide arménien de 1915 et la Nakba. Malgré les nombreux points communs entre les luttes palestiniennes et arméniennes, les mouvements internationaux solidaires de la Palestine ont longtemps négligé ces liens, alors même que les pouvoirs coloniaux ne cessaient de se renforcer les uns les autres via notamment le trafic de pétrole et d’armement.
A l’heure où l’Etat azerbaïdjanais construit des alliances avec des mouvements indépendantistes dans certaines colonies occidentales, passant sous silence son propre caractère impérialiste, nous traduisons le texte « Where Scenes of Catastrophes Reappear: On Armenian and Palestinian Solidarities », écrit par Machinka Firus Hakopian et initialement paru sur le site de Social Text Journal le 8 février 2024.
En esquissant quelques parallèles entre les vécus palestiniens et arméniens, ce texte important cherche à repenser la solidarité entre opprimé-es en recentrant les récits transmis par les survivant-es des génocides. Se rendre témoin de cet héritage, c’est s’opposer aux tactiques négationnistes que les Etats-colons déploient afin d’effacer toute trace de la résistance à leurs projets destructeurs. — DLB.
Au mois d’août dernier, j’ai assisté à une projection du film Aurora, une étoile arménienne au cinéma New Plaza à New York. Le documentaire raconte l’annihilation des mondes vécus arméniens au sein de l’Empire ottoman au début du vingtième siècle. En août, le film a été accueilli comme un projet d’archive. Les spectateur-ices ne savaient pas encore qu’il s’agissait aussi d’une prémonition.
Seulement quelques semaines plus tard, la déportation massive des arménien-nes d’Artsakh a été enregistrée sur des écrans numériques, réglée sur la violence épistémique du négationnisme. Les descendant-es voyaient les récits ancestraux, racontés une nouvelle fois, reprendre vie en temps réel. Les pertes s’accumulant au présent se surimposaient sur celles du siècle dernier : un palimpseste d’expulsions apparaissait scintillant au regard.
Dès la fin du mois de septembre, l’exode de plus de 10,000 artsakhtsi-es serpentant les cinq kilomètres du corridor de Latchine [la seule voie d’accès reliant la région du Haut-Karabagh à l’Arménie] formait un motif visible depuis l’espace. Enregistrées par les satellites de Maxar Technologies, les images de cette scène ont plus tard retrouvé leur chemin jusqu’aux diptyques photographiques circulant sur les plateformes numériques. Sur ces diptyques, les images satellites sont juxtaposées avec la photographie historique des arménien-nes empruntant le chemin des marches de la mort à travers le désert syrien jusqu’à la ville de Deir ez-Zor.

Les images du diptyque sont respectivement étiquetées « 1915 » et « 2023 ».
Au début du mois d’octobre, une campagne de violence génocidaire toujours en cours s’est intensifiée en Palestine, tuant des milliers et s’appropriant les mondes vécus des millions de personnes. La plupart d’elles avaient été plusieurs fois exilées, témoins de la dépossession successive de chaque génération les ayant précédées. Au moment où les palestinien-nes vivaient une déportation de masse depuis leurs maisons du nord de Gaza, le journaliste Amjad Shabat remarquait : « J’ai vu une file de voitures s’étendre sur un peu plus de 15 kilomètres… Il s’agissait d’une scène similaire à celle décrite de nombreuses fois par ma grand-mère à propos de la Nakba. » Des diptyques ont été composés à partir des photographies de la marche actuelle vers le sud et celles d’il y a soixante-dix ans.

Celles-ci sont respectivement étiquetées « 1948 » et « 2023 ».
Chacun de ces diptyques doublant les catastrophes arménienne et palestinienne contient en lui la possibilité d’un triptyque, un quadtyque, voire un polyptyque. Chacun des panels représente l’indexe de récursivité de la violence coloniale, une structure dont l’horreur est réitérable à l’infini. Au-delà du cadre du diptyque existe un plan d’atrocités à n dimensions recouvrant plusieurs coordonnées spatio-temporelles. Celui-ci n’est pas illustré.
Ces diptyques attestent des liens trans-historiques entre les luttes de libération palestinienne et arménienne, amenant à la surface leurs contiguïtés aussi bien que leurs asymétries et les points de divergence. Les luttes discontinues qu’ils rendent visibles sont tissées ensemble par les fils entremêlés de la résistance aux forces de l’occupation, la normalisation d’une violence génocidaire, le capital pétrolier, les circuits des subventions militaires des États-Unis, ainsi que l’assimilation des populations autochtones à de simples obstacles effaçables sur le chemin de la construction des États-colons.
Celleux d’entre nous qui sommes familier-es de ces scènes via la transmission ancestrale, nous nous sommes écrié-es en affirmant les avoir déjà vues. Nous savons ce qui apparaît ensuite et qui disparaît, si tout cela est suivi par l’inaction. La boucle récurrente de la violence coloniale produit des sujets et des témoins capables de prédire l’image suivante d’un diptyque avec une précision souvent à tort imputée aux algorithmes.
Dans ce contexte-là, l’un de mes anciens m’a dit : « Les photographies de nos ancêtres se répètent. »
Qu’est-ce que cela veut dire d’être originaire d’une partie du monde où les scènes des catastrophe resurgissent d’un siècle à l’autre, tout en demeurant invisibles dans les deux temporalités ?
*
Dans les semaines qui ont suivi cette projection d’Aurora, une étoile arménienne, les événements historiques que le film mettait en scène sont revenus une fois de plus.
Depuis le mois de décembre 2022, le peuple de l’Artsakh avait été illégalement assiégé par l’ethno-État azerbaïdjanais autoritaire et riche en pétrole. Celui-ci agissait avec l’aval total de la Turquie, dont il partage la devise : « une nation, deux États ». La Turquie poursuit une politique érigée en loi concernant la négation du génocide arménien perpétré en 1915 et pénalise toute référence au génocide d’une peine d’emprisonnement.
Les dirigeants de ces deux États adhèrent à l’idéologie ethno-territoriale du panturquisme. Le maire de la capitale azerbaïdjanaise a explicitement affirmé en 2005 : « Notre objectif est l’élimination totale des arménien-nes. » Il a depuis été promu au poste de premier ministre adjoint.
Ignorant les documents historiques qui attestent à l’indigénéité arménienne dans la région, le président azerbaïdjanais Ilham Alïev a déclaré : « Le Haut-Karabagh est notre terre. » Ainsi que : « C’est la fin… On les chasse comme des chiens. » Les autorités azerbaïdjanaises ont recours à ce genre de vocabulaire déshumanisant de manière routinière pour décrire les arménien-nes et signalent ainsi clairement leurs intentions génocidaires. Elles partagent cette tendance à la rhétorique génocidaire avec les dirigeants israéliens qui ont décrit les palestinien-nes comme étant des « animaux humains » ou des « enfants de l’obscurité » obéissant à la « loi de la jungle ».
En août 2023, suite à huit mois de blocus, un rapport publié par un procureur fondateur de la Cour Pénale Internationale a classé la situation en Artsakh comme étant un « génocide par la faim ». La population était privée de nourriture, de carburant et de médicaments. Les livraisons d’aide humanitaire étaient interdites. Puis, le 19 septembre, l’Azerbaïdjan a envoyé des drones de combats, des missiles et l’artillerie contre les civiles d’Artsakh et leurs infrastructures sous prétexte d’opérations « anti-terroristes ». Suite à un jour de bombardement continu, la République [d’Artsakh] a capitulé et son président Samvel Chahramanyan a plus tard signé un décret indiquant que son État « cesserait d’exister ».
Avant la fin du mois de septembre, 120,000 arménien-nes autochtones d’Artsakh ont été expulsé-es de force des terres avec et sur lesquelles leurs ancêtres avaient vécues depuis des millénaires. Aujourd’hui, il n’y reste pas plus d’une cinquantaine d’arménien-nes.
En octobre, l’Azerbaïdjan annonçait son intention d’installer 140,000 azerbaïdjanais-es sur les terres arméniennes occupées d’ici 2026. Ces colons pourront un jour se balader dans une rue de Stepanakert occupé, récemment renommée après Enver Pacha, l’un des architectes principaux du génocide arménien de 1915.
*
Les photographies de nos ancêtres se répètent, tout en demeurant invisibles aux yeux du monde entier.
Une photographie en particulier me revient régulièrement. Elle fait partie d’un certain type de documents que l’on retrouve souvent dans des archives familiales arméniennes : les images des personnes qui ont existé avant 1915 et qui n’ont cessé d’exister après. Ce portrait jauni représente mon arrière-grand-père, un marchand de tapis, avec sa femme à Van – situé à l’époque en Arménie occidentale et faisant désormais partie de la Turquie. Ces deux forment un couple remarquable, distingué par les atours choisis pour la photo. Chacun-e des deux projette sans effort un air régalien. Le regard de l’homme sort du cadre, pendant que celui de la femme confronte la caméra sans broncher.
Plus tard, les deux ont fui Van pendant le génocide, qu’il a survécu. Pas elle. On les a stoppé-es durant leur échappée. Le couple était momentanément séparé lorsqu’un coup de feu a éclaté. Il est revenu sur ses pas et l’a découverte morte d’un arrêt cardiaque provoqué par la terreur survenue au moment où elle a entendu le tir retentir.
La première fois qu’on m’a raconté cette histoire, je me suis demandée comment il pouvait être certain que c’était bien la terreur qui lui avait ôté la vie. Enfant arménienne, mais éduquée au sein du noyau de l’empire états-unien, j’avais appris à considérer que, même une fois morte, elle devait fournir des preuves substantielles de sa souffrance.
Depuis le mois de septembre, je vois cette photographie se répéter tous les jours.
*
Soumis à un blocus et finalement bombardé-es en 2023, les arménien-nes d’Artsakh ont produit de vastes archives visuelles documentant les conditions génocidaires auxquelles on les avait soumis-es et ont imploré le monde d’en être témoin.
Des images fantomatiques de supermarchés aux rayons vides avaient circulé pendant plusieurs mois. Une vidéo montrait un enfant de douze ans passer les nuit en faisant la queue pour le pain afin de récupérer la ration journalière de sa famille le matin, rentrant souvent bredouille, car les réserves étaient épuisées.
Un convoi de camions d’aide humanitaire bloqués restait garé au milieu du corridor de Latchine à la vue de tout le monde.
Une photo partagée par le journaliste Siranouche Sargyssan basé à Stepanakert montrait des enfants blottis dans un abri antiaérien avec la légende suivante : « Je dors avec les enfants qui hier rêvaient de pain et aujourd’hui rêvent de se lever demain. Je ne sais pas si nous allons nous réveiller le matin, mais j’espère que vous vous souviendrez de nous pour avoir résisté au génocide avec honneur. »
Des images de corps mutilés, d’un jardin d’enfant bombardé et d’infrastructures civiles ravagées ont proliféré.
Qu’est-ce qu’il faudrait, je me demandais, pour contraindre les observateur-ices à voir ces images ? A se rendre compte que les photos de nos ancêtres se répétaient ?
Après avoir accompli le nettoyage ethnique de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan a commencé à planter les graines de l’envahissement futur et de l’annexion du territoire souverain arménien. Une déclaration récente de son ministre des affaires étrangères prétend que les habitant-es de huit villages internationalement reconnus comme appartenant au territoire arménien empêchaient la paix et la sécurité en « occupant » leurs propres terres ancestrales.
Les commentateur-ices du monde entier publieront des avertissements. Des organisations des droits humains pointeront du doigt des preuves d’intentions génocidaires manifestes. Des images de catastrophes provoquées par le régime circuleront sur les plateformes numériques. Des écrivain-es vous supplieront de regarder, comme je le fais maintenant.
*
Une semaine après que le déplacement forcé de toute la population de l’Artsakh ait abouti, la campagne de dépossession et de déplacement des palestinien-nes de la bande de Gaza déjà en cours s’est intensifiée à une échelle insondable.
Au moment de l’écriture, plus de 24,000 palestinien-nes ont été assassiné-es, dont plus de 10,000 enfants. [Aujourd’hui, en avril 2025, ce chiffre a largement dépassé les 50,000 mort-es. — DLB] Plus de 825 familles de plusieurs générations ont été entièrement effacées du registre civil, ne laissant aucune trace physique de leurs lignées ancestrales. Au moins 117 journalistes ont été ciblé-es et tué-es, souvent avec leurs familles toutes entières. Plus de 70 % de logements à Gaza ont été détruits ou endommagés, et plus de 1,9 million de palestinien-nes ont été déplacé-es, ce qui représente 85 % de la population totale de Gaza. Plus de 90 % de la population est extrêmement affamée, la famine généralisée étant prévue pour le mois de février.
Le ministère de la santé a depuis longtemps annoncé « la faillite totale du système de santé et des hôpitaux dans la bande de Gaza », pendant que le bombardement des infrastructures médicales se poursuit. Malgré tout, il paraîtrait que le monde a l’intention de regarder passivement jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun-e palestinien-ne sur ses terres d’origine.
L’inaction rencontrant les preuves documentées de la violence génocidaire en Palestine témoignent des limites de la vision des catastrophes provoquées par le régime comme une force politique galvanisante. Ces limites sont particulièrement mises en relief dans un scénario asymétrique décrit par Ariella Azoulay au sein duquel les personnes qui regardent « sont capables d’observer la catastrophe depuis une position de relative sécurité, alors que les personnes observées… peuvent se voir infliger un désastre et ensuite être regardées subsistant dans leur état de détresse ».
Ou bien, comme le formule le chercheur Saree Makdisi, « les gens ont l’air de ne pas voir ou reconnaître la souffrance palestinienne, car ils ne la voient littéralement pas, ni ne la reconnaissent. »
*
Face aux scènes qui se déroulent à Gaza, Amjad Chabat écrit : « J’ai grandi avec les histoires de la Nakba racontées par ma grand-mère. Aujourd’hui, je raconte l’histoire de la Catastrophe de 2023. » Je lis ses mots en même temps que ceux des personnes nouvellement déplacées depuis l’Artsakh, qui rapportent avoir vécu un deuxième Mets Yeghern, un terme utilisé par les arménien-nes pour désigner le génocide de 1915, qui se traduit par le « Grand Crime ». Qu’est-ce que ça veut dire d’être témoin de ces répétitions l’une à côté de l’autre : la Catastrophe et le Grand Crime ?
De manière cruciale, les États qui cherchent à effacer l’Artsakh et la Palestine se sont arrangés de façon à former un triptyque, dans une relation de pouvoir, de capital pétrolier et de militarisme triangulés, au sein de laquelle les États-Unis constituent le troisième sommet. Il n’est pas anecdotique que l’Azerbaïdjan fournisse à Israël près de 40 % de son pétrole. La compagnie de pétrole SOCAR appartenant à l’État azerbaïdjanais était parmi les 6 entreprises auxquelles Israël a offert des permis de prospection de gaz naturel en Méditerranée le 29 octobre [2023]. Le 19 octobre, au milieu du bombardement de Gaza, l’Azerbaïdjan a envoyé plus d’un million de barils de pétrole à Israël dans un pétrolier de près de 300 mètres de longueur portant le nom « Seaviolet ». Son statut de pays riche en pétrole a depuis longtemps protégé l’Azerbaïdjan de l’obligation de rendre compte des violences étatiques, comme le décrit en détail une enquête majeure produite par l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Celle-ci révèle un système de blanchiment d’argent à hauteur de plusieurs milliards de dollars en lien avec l’État azerbaïdjanais.
Le 8 novembre, l’ambassade israélien a publiquement félicité l’Azerbaïdjan à l’occasion de sa « Fête de la victoire ». La victoire en question est le nettoyage ethnique des arménien-nes commis par l’Azerbaïdjan et l’envahissement de l’Artsakh. Israël a fourni à l’Azerbaïdjan ce qu’on estime être 70 % de son arsenal militaire, créant les conditions qui ont rendu possible cette victoire. Israël a puisé dans un arsenal qui comporte historiquement 80 % d’importations depuis les États-Unis, renforcé par 3,8 milliards de dollars d’aide militaire annuelle. Au même moment où ils fournissaient les trois quarts de l’arsenal israélien, les États-Unis ont envoyé environ 808 millions de dollars d’aide financière à l’Azerbaïdjan entre 2002 et 2020, tout en échouant à fournir « des instructions détaillées concernant l’information devant être fournie pour ses rapports au Congrès ». C’est seulement après que le nettoyage ethnique de l’Artsakh encouragé par les États-Unis s’achève que le Sénat américain vote de mettre fin à de l’aide militaire supplémentaire destinée à l’Azerbaïdjan le 16 novembre. Pendant ce temps-là, alors même que des procédures relatives au génocide sont en cours à la Cour internationale de justice, le Sénat vote contre une résolution appelant à scruter l’aide militaire envoyée en Israël.
Une déclaration récente de l’Institut Lemkine pour la prévention des génocides, organisme non-partisan, souligne le rôle des États-Unis dans la facilitation de la violence génocidaire dans l’Artsakh et en Palestine. Intitulée « La déclaration de deuil pour les gazaoui-es et le monde entier », le texte remarque la chose suivante concernant les États-Unis et Israël :
Cela vaut le coup d’être noté que ces deux puissances militaires majeures sont en train de commettre un génocide à Gaza seulement quelques semaines après avoir activement rendu possible un génocide contre un autre peuple assiégé : les arménien-nes de l’Artsakh, déplacé-es de force de leurs terres d’origine par l’armée azerbaïdjanaise en septembre [2023]. Si le monde permet à ces deux pouvoirs de continuer à agir avec autant d’impunité, alors le génocide deviendra la norme politique aussi bien parmi les dictatures que les soi-dites démocraties.
En remontant plus loin dans le passé, l’histoire des arménien-nes et celle des palestinien-nes s’entremêlent depuis longtemps. Les communautés arméniennes en Palestine existent depuis au moins le quatrième siècle après Jésus Christ, formant la plus ancienne diaspora arménienne au monde. Des milliers d’autres arménien-nes arrivent en plein milieu du génocide de 1915. Pendant la Nakba, plusieurs milliers d’arménien-nes sont aussi expulsé-es de leurs maisons et, selon l’historien Bedross der Matossian, les communautés arméniennes qui se trouvaient sur « les territoires qui deviennent israéliennes par la suite sont réduites à l’insignifiance ».
En 2000, lorsqu’Israël cherche à prendre le contrôle du quartier arménien occupé de Jérusalem, Yasser Arafat réplique : « Le quartier arménien nous appartient, les arménien-nes et nous-mêmes sommes un seul et même peuple. » Les arménien-nes vivant à Jérusalem-Est se voient octroyer le même statut que les palestinien-nes : « résident-es, mais pas citoyen-nes, effectivement privé-es d’État ». Comme l’un des habitant-es du quartier raconte à l’écrivaine Nancy Kricorian à propos des arménien-nes et des palestinien-nes : « Nous respirons le même gaz lacrymogène. »
Alors que le bombardement continu de Gaza s’intensifie, les arménien-nes de Goverou Bardez (le « Jardin des vaches » du quartier arménien dans la vieille ville de Jérusalem) assistent à l’assaut du terrain par des colons israéliens armés et accompagnés de chiens d’attaque. Les colons déclarent être propriétaires du terrain et menacent les arménien-nes présent-es de les « attraper un-e par un-e ». L’un de ces colons a été lié au ministre israélien de la sécurité nationale. Le 16 novembre, des chefs religieux publient de toute urgence un communiqué, avertissant que « le Patriarcat arménien de Jérusalem fait potentiellement face à la plus grande menace d’ordre existentiel de toute son histoire longue de 16 siècle ».
Les bulldozers sont apparus sur place afin de démanteler les barricades construites par les habitant-es du quartier, cherchant à s’approprier les terres de la diaspora arménienne la plus ancienne au monde afin de les convertir en un centre de vacances ultra-luxurieux. Résistant à la violence coloniale et aux grenades lacrymogènes, les arménien-nes du quartier se sont organisé-es pour mener une lutte collective, écrivant que « le Jardin des vaches n’est pas seulement un bout de terrain, mais un lieu de dépôt de souvenirs ».
*
Immédiatement après avoir vu les photos des arménien-nes dans le Jardin des vaches cherchant à repousser la dépossession et le déplacement, je rencontre une photographie faite par Belal Khaled. Elle dépeint l’expérience d’une femme nonagénaire qui s’appelle Anaam. Elle a été déplacée deux fois dans sa vie : une fois depuis son village natal durant les massacres de la Nakba, une seconde fois à l’heure acturelle depuis le nord de Gaza. Elle fait les cinq kilomètres du voyage forcé vers le sud à pied, soutenue par des individus de chaque côté qui la lestent tout du long. La légende de Khaled note que suite au premier déplacement, elle a « gardé la clé de sa maison dans l’espoir de retourner chez elle un jour ».
Une photographie contemporaine de Scout Tufankjian montre une école à Aralez, en Arménie, qui accueille désormais des réfugié-es de l’Artsakh. Au sein de l’école, pend une tapisserie de clefs représentant toutes celles appartenant aux arménien-nes forcé-es à quitter leur maison en 1915.
Aucune symétrie ni équivalence ne saurait être tracée entre ces images. Néanmoins, les voir l’une à côté de l’autre nous permet de visualiser les histoires interconnectées de l’ethno-territorialité et de la violence génocidaire qui se rendent possibles les unes les autres.
Les arménien-nes et les palestinien-nes partagent une expérience commune des vécus rendus invivables sur leurs terres d’origine. Le plus important, c’est que nous partageons une résistance à l’oubli, car nous avons été témoins à répétition de projets cherchant à décimer et, par la suite, faire oublier les mondes que nous avions construits.
Kegham Djeghalian, un photographe arménien né à Jérusalem, a déménagé sa maison et son atelier à Gaza, là où il a pu documenter la Nakba, la Guerre des Six Jours et les conditions de vie dans des camps de réfugié-es. Ses photos présentent des mondes vécus menacés d’effacement : des familles en pique-nique, des retrouvailles au bord de la mer, un enregistrement d’un cour d’art féminin qui paraît dater des années 50, son émulsion se froissant.
Le poète palestinien Najwan Darwich témoigne lui aussi de la persistance de la mémoire collective. Son poème, « Qui se rappelle des arménien-nes ? », déclare :
Je me souviens d’eux,
Et je prends le bus de mes cauchemars avec eux
Chaque nuit et mon café,
Ce matin je le bois avec eux
Toi, l’assassin :
Qui se rappelle de toi ?
Les diptyques documentant les répétitions de 1915 et de 2023, de 1948 et de 2023, sont instructifs. Placés les uns à côté des autres, ils deviennent une grille faite de tentatives d’effacement enchevêtrées, défaite par le refus d’être effacé-e.
Qu’est-ce que ça peut vouloir dire de venir d’un endroit au monde où les scènes de catastrophes réapparaissent d’un siècle à l’autre, tout en demeurant invisibles dans les deux temporalités ? Ces scènes exigent de nous de cultiver des solidarités intrépides, une praxis collective de se porter témoin et une action de coalition.
Une forme particulière du savoir intuitif s’accroît chez les descendant-es qui assistent à la récurrence de la violence coloniale. Un moyen de savoir quelle transmission prendra corps, transférée de génération en génération. Une sorte de faculté de prévision qui permet à l’observateur-ice de prédire la prochaine image d’un diptyque avant que celle-ci n’apparaisse. Cette forme de savoir porte avec elle un devoir : une responsabilité de parler, d’agir, de chercher à empêcher les futures récurrences de se matérialiser.
***
L’image de couverture : selon l’ordre de l’aiguille d’une montre depuis la gauche : 1. Enfants arméniens évacués de Kharpout par Near East Relief, 1922-23. Via le Musée-institut du génocide arménien. (Source) 2. Exilé-es palestinien-nes en route depuis Jérusalem jusqu’au Liban le 9 novembre, 1948. Via AP Photo/Jim Pringle, File. (Source) 3. Les palestinien-nes se servant de la route de Salah al-Din afin de fuir vers le sud de la bande de Gaza en 2023. Via Hatem Moussa/AP Photo. (Source) 4. Les images satellite des arménien-nes déporté-es de l’Artsakh dans le corridor de Latchine le 26 septembre, 2023. Via AP / Maxar Technologies. (Source)
Ce texte est redevable au travail éditorial de Jasbir Puar.