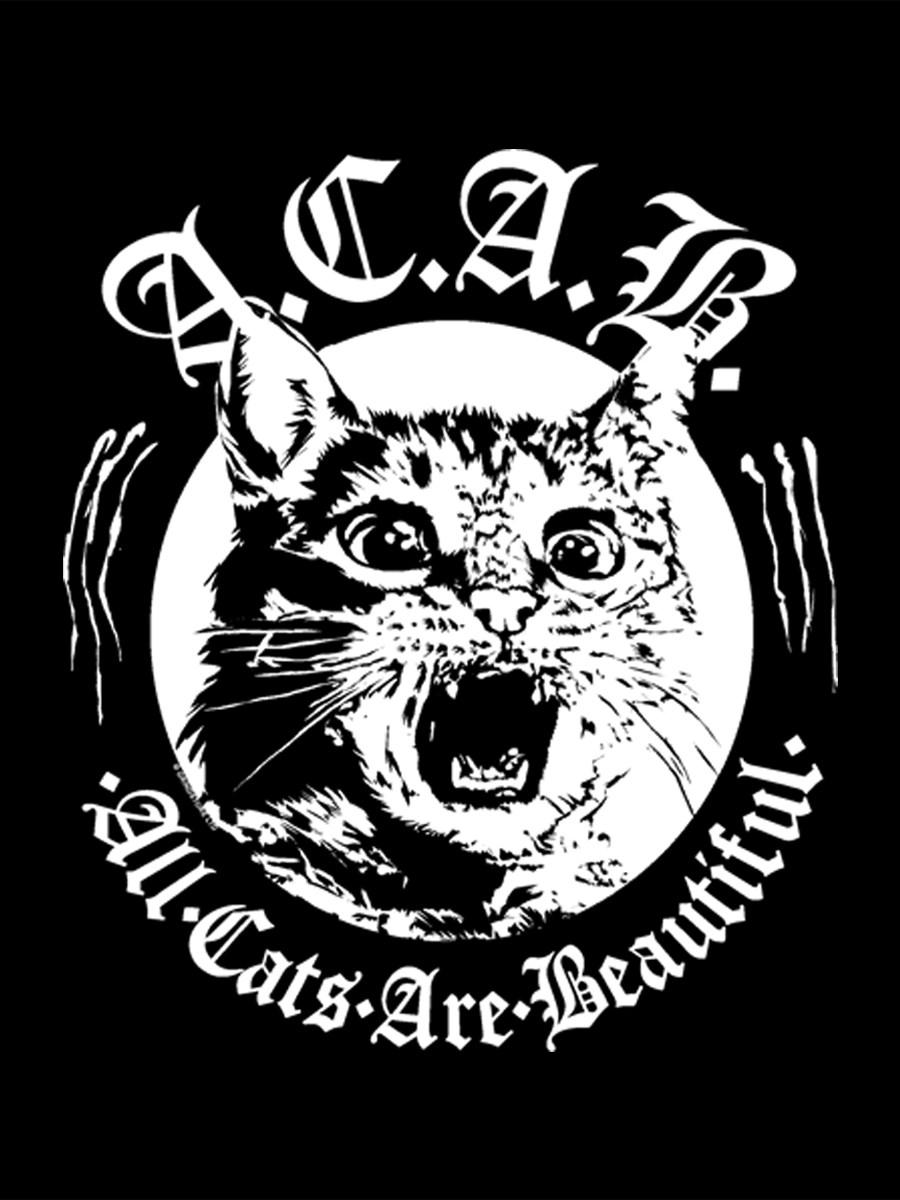à L., B. et K., parti-es en 2024
Pour enfin clôre l’année passée, marquée par la continuation ininterrompue du génocide palestinien et, plus proches de nous, les morts de plusieurs ami-es et les expulsions effrénées de lieux occupés qui nous donnaient l’espoir, nous traduisons le texte « If We Go, We Go On Fire » signé Ignatius, initialement paru sur le site de la Bibliothèque anarchiste. Ce texte très riche nous a fait écho, en faisant ressortir ce qui, dans le deuil, pouvait constituer une arme redoutable aussi bien que ressource dans laquelle puiser pour se révolter de manière plus sincère en s’attaquant aux racines de ce qui nous fait souffrir au quotidien. Ces mots nous ont aussi un peu rappelé ces quelques lignes d’un texte anonyme sur le suicide diffusé il y a quelques années sur un site qui a été mis hors ligne depuis :
« le deuil cultive en nous une plus grande sensibilité aux fêlures par lesquelles le vivant s’échappe. armé-es de cette vulnérabilité nouvelle, on peut enfin briser jusqu’à dans nos gestes l’indifférence que la société cherche à nous inculquer face aux personnes dont on peut partager la détresse. la puissance du deuil est capable de soigner notre rapport à la révolte, en lui redonnant une nouvelle responsabilité et un nouvel objectif : faire vivre coûte que coûte les rêves brisés de nos compagnon-nes défunt-es. »
Note de DLB : nous avons choisi de traduire « grief », qui évoque à la fois un processus actif (faire le deuil de quelqu’un-e…) et un sentiment de douleur, par plusieurs mots (deuil, chagrin et, parfois, souffrance et douleur) afin de mieux transmettre sa polysémie.
I. Reprendre de l’air
Si je te donne un couteau
Peux-tu me tailler des bronchies
Pour que je puisse enfin respirer
Dans cette boue saumâtre
C’est le début du mois de décembre 2024. Tout ce que j’ai pu écrire cette dernière année commençait par les mêmes notes contextuelles. J’indique le mois en cours et j’affirme que l’État d’Israël continue à exercer une violence génocidaire contre le peuple palestinien, avec le soutien illimité des Etats-Unis. J’affirme que la police continue à assassiner avec impunité les jeunes autant que les vieux dans leur cour de maison et dans leur cuisine, dans les stations de métro et dans les immeubles. J’affirme que notre monde est dominé par et construit sur les horreurs du racisme anti-Noir, du colonialisme, du validisme, du cishétéropatriarcat, et tant d’autres piliers de la violence oppressive. J’indique que le loyer est dû et que le froid commence à devenir glacial. Rien n’a changé. Tout cela reste la réalité à l’intérieur de laquelle nous existons. Chaque texte que je rédige s’inspire d’une espèce de volonté intérieure me poussant à communiquer quelque chose qui ferait sens depuis ce gouffre du désir-désespéré-pour-quelque-chose-de-différent-à-ce-qui-existe-déjà que j’appelle chez moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais ce texte en particulier est tiré de mes veines avec un peu plus de douleur personnelle, je vais donc faire quelques affirmations supplémentaires concernant le moment présent.
Il y a trois semaines, j’ai appris qu’un-e vieil-le ami-e était décédé-e, troisième en autant d’hivers. « Ami-e » n’est pas forcément le mot juste, mais c’est plus facile à dire que quelqu’un que je croisais dans la rue lors de situations incroyablement stressantes, mais avec qui je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de passer du temps. Donc je vais juste dire « ami-e ». Je n’avais pas pensé à ellui depuis au moins deux ans et maintenant je me réveille tous les matins, chaque fois dans un nouveau canapé ou lit d’ami-e, retrouvant un autre souvenir ensemble que je croyais effacé par le passage du temps. Chaque souvenir semble débloquer un sentiment de deuil plus profond qui sommeillait au fond de moi depuis longtemps.
Il n’y a aucune logique au va-et-vient des vagues lorsqu’une pensée quelconque capture mon attention si longtemps que j’oublie de petit-déjeuner, puis de déjeuner. Au bout d’un moment, il fait déjà nuit, je n’ai plus l’énergie de me débrouiller pour trouver quelque chose à dîner et je me couche le ventre vide. La sensation de faim offre un confort relatif, comparée au sentiment d’angoisse existentielle dont elle me détourne. Je fixe le mur et je me remémore la mort de DeAndre Ballard, tué par un vigile à l’extérieur de son logement universitaire. À ce moment-là, nous n’avons même pas été capables de foutre assez de pression à la municipalité pour qu’elle diffuse les images de vidéosurveillance. Je me suis rapproché-e de son oncle alors que les manifestant-es venaient de moins en moins nombreux-ses, et que le monde ainsi que le vent paraissaient plus tranchants. La dernière fois que l’on s’est croisé-es, je me rappelle qu’on s’est serré-es dans les bras à l’entrée d’un Walmart. Il m’a dit qu’il avait pdes images des porcs me bottant le cul pendant une manif transformée en tabassage. Il m’a demandé-e si ça pouvait m’aider devant le tribunal. C’était il y a déjà quatre ans.
Je repense à la dernière fois où j’étais inculpé-e, juste après que je me fasse botter le cul justement, à quel point j’étais terrifié-e de rentrer dans une salle de tribunal, à quel point je me sentais seul-e à fixer le juge le jour de ma dernière audience. Seul-e dans le sens où aucun-e camarade ne m’accompagnait, mais ensemble avec tout le reste des gens qui se confrontaient à la justice en étant aussi seul-es. Ça n’allait pas de soi que la chose principale qui me garde en dehors de taule soit la pression qui a étouffé le procureur adjoint juste avant que mon avocat l’enfonce encore plus au moment du début de l’audience. Depuis quatre ans, c’est devenu une blague récurrente entre mes ami-es que, selon moi, les pantalons puissent être des vêtements de tribunal. Il est plus évident de surenchérir sur cette blague que d’admettre qu’enfiler n’importe quelle tenue ressemblant de près ou de loin à ce que je portais à l’audience retourne mon estomac dès que je m’aperçois dans la glace.
Ces pensées associées à un chagrin aigu finissent forcément par céder leur place à un deuil plus vaste et impersonnel qui accompagne chaque intention ou prise de conscience dans ce monde peuplé de machines de mort. Chaque manifestation de génocide, chaque acte de violence policière, chaque expulsion, chaque attaque d’une occupation militante, chaque personne privée de soins, chaque heure de vie sacrifiée à l’autel du travail fait monter le chagrin dans mon sang jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau toxique. J’ouvre ma bouche pour crier, mais aucun son n’en sort. J’essaye de suivre le cour de ma journée, mais mon cerveau est fondu et il me coule par le nez. J’essaye d’avaler la tristesse jusqu’à ce qu’elle m’étouffe, menaçant de me brûler de l’intérieur. J’ai peur. Je me jette contre les vagues, me débattant jusqu’à l’épuisement. Enfin, je commence à couler.
Pourtant, malgré la peur et l’épuisement, il y a quelque chose de puissant à trouver en-dessous des vagues, lorsque ta bouche se remplit de sable et que l’eau envahit tes poumons. A travers la douleur et le désespoir surgit une clarté à laquelle seul le deuil insurmontable peut donner accès. Le deuil n’est pas simplement quelque chose qui nous arrive et qu’on devrait avaler. Il nous offre un cadre, une logique contre la logique qui semble découper le monde en deux, séparant ce qui vaut le coup de ce qui n’en vaut pas, ce qu’on désire de ce qui nous est imposé. Le deuil ne devrait pas être une charge à porter, ou pas seulement en tout cas.
Notre deuil peut nous servir d’arme.
II. Deuil comme cadre/arme
Force à celleux qui manient leur peine
comme un couteau à la gorge du monde
Comme je l’ai déjà exprimé, le deuil offre une logique contre la logique qui coupe le monde en deux. Quand je dis « une logique contre la logique », je fais référence au fait qu’en dehors de l’expérience du deuil, on a souvent recours à un sens de préservation de soi en tant que faisant partie d’un statu quo. Même les soi-disant radicaux-les choisissent fréquemment d’agir (délibérément ou non) de façon à reproduire chaque jour passé dans le suivant. Tout perdure, et rien ne change.
Cependant, le deuil (surtout sous sa forme aiguë) est la chose dont j’ai pu faire l’expérience qui nous permet de discerner de façon la plus claire et spontanée ce qui est significatif au milieu de ce qui participe lentement à l’atrophie de nos sens. Le spectacle de la forme-marchandise, jadis si séduisant et captivant, ne devient rien de plus qu’une lumière stroboscopique détruisant notre capacité à voir dans l’obscurité. Le travail, autrefois une source de tant de stress et de peine, devient tout simplement une série de mouvements répétitifs qu’on exécute sans y prêter réflexion (si tu te foires, ça n’a pas d’importance, être viré-e serait une bénédiction, et tu aiderais volontiers ton patron à mordre le pavé s’il pensait que tu devais t’agiter un peu plus).
Avec cette clarté de sens vient la clarté concernant ce qu’on devrait réellement craindre. Des peurs plus profondes commencent à hanter notre quotidien. « Si j’engueule mon patron, je pourrais être licencié-e » est remplacé par « Si je perds ma vie à ce faire ce boulot, je mourrais en me haïssant. » « Si je me bats contre ce flic, je vais être tabassé-e, emprisonné-e ou tué-e » est remplacé par « Si je passe à côté de ce flic en l’ignorant, le monde de sa brutalité continuera sans fin. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Les institutions à l’origine de notre souffrance apparaissent moins dissimulées, leur violence se faisant plus explicitement ressentir et visible lorsque nos peurs entament leur transformation. Dès que nous nous autorisons à interroger non seulement ce qui est, mais pourquoi ça l’est, il devient impossible de ne pas s’apercevoir qu’autant de nos souffrances manquent cruellement de sens. Il devient impossible de ne pas reconnaître que ça ne peut vraiment pas continuer de cette manière-là.
En plus de transformer nos craintes, le deuil a une certaine capacité à déformer la linéarité du temps. Les secondes mettent des années à s’écouler et on a l’impression de pouvoir compter chaque cellule de son corps. Les journées se mesurent en nombre de battements de cœur et de vides dans lesquels on s’engouffre ou ceux qu’on arrive à éviter de justesse. L’ordre des événements et le temps qui les sépare les uns des autres deviennent impossibles à déterminer. Des souvenirs vieux de plusieurs décennies rentrent par effraction dans le crâne avec toute l’intensité des émotions fraîchement vécues. On conduit en pilote automatique jusqu’à se retrouver devant la maison d’un-e ami-e qui n’y habite plus depuis des années, en oubliant qu’iel a changé de ville. Aussi déstabilisantes que sont ces expériences, elles poussent nécessairement à remettre la réalité en question. On se sent obligé-e de regarder de plus près tout ce qui nous entoure et d’interroger le sens même de ce qui est « réel ». Et si cette réalité-là n’était rien d’autre que ce qui a généré notre peine et notre souffrance en premier lieu, pourquoi ne pas la remplacer par quelque chose de notre propre conception ?
Ainsi, lorsque nous glissons dans le deuil, notre volonté d’interroger la réalité existante se renforce, nos peurs se transforment, ce qui peut nous amener à réévaluer nos priorités. Plus nous acceptons d’incarner le deuil que nous vivons, plus nous remettons en question les structures qui nous entourent, plus nos craintes s’éloignent de l’auto-préservation pour se rapprocher de l’existentiel, et plus nous sommes disposé-es à vivre en accord avec les mondes que nous prétendons désirer. On prend plus volontiers des risques, car on reconnaît avoir déjà tant perdu et continuer à perdre activement de plus grosses parties de nous-mêmes avec chaque nouveau jour où ce monde mortifère persiste dans son existence.
C’est quelque chose qu’on observe avec le plus de clarté lors des veillées qui tournent en émeute. Combien de fois avons-nous vu des rassemblements, initialement prévus pour pleurer une personne assassinée par la police, devenir des foyers de révolte. Les cris de détresse adressés à personne en particulier deviennent des menaces articulées à l’adresse des incarnations physiques des causes de notre deuil. « Mains en l’air, ne tirez pas » devient « Va te faire foutre, on va riposter ». Dès qu’on se rend compte que tout ce qu’on attend de nous (et de celleux qu’on aime), c’est qu’on souffre puis crève et que ce principe sert de pierre de voûte à ce monde, la peine que cette réalisation provoque en nous prend forme des briques frappant les pare-brises des 4×4, des battes de baseball fracassant les fenêtres des taules, des pavés caillassant les lignées de flics anti-émeute, et des douilles de balles balisant nos trottoirs. La logique de l’auto-préservation est retournée à l’envers. Pour beaucoup, il n’existe pas de « soi » à préserver dans un monde où on est défini par sa capacité à servir la machine du capitalisme racial. Si vivre dans le monde existant, c’est vivre assujetti-e à cette machine, alors le seul chemin vers une vie digne d’être vécue serait de le détruire par tous les moyens nécessaires, ou bien de mourir en essayant.
Afin d’incarner pleinement notre deuil, nous devons être prêt-es à nous rapprocher de cette logique contre la logique, d’embrasser le désir brut de rejeter en bloc tout ce qui nous entoure et d‘exprimer la souffrance que nous avions appris à subir en privé dans la sphère publique et marchande. Nous devons obliger ces sphères-là à subir, collectivement, le poids de la douleur qu’on était forcé à avaler dans l’isolement individuel. Mais que faudrait-il pour vivre pleinement notre deuil plutôt que de le réprimer en cherchant à prioriser notre bon fonctionnement au sein d‘une société qui nous tue déjà ?
III. Deuil et guerre sociale
Jusqu’ici tout va bien
Jusqu’ici tout va bien
Jusqu’ici tout va bien
L’aboutissement logique de la pleine expérience du deuil est la guerre sociale, un rejet en bloc de l’existant comme forme de vie quotidienne. Aucune manière d’exprimer notre peine n’est plus authentique que celle qui exige que le monde qui nous entoure s’effondre en tremblant au rythme de notre respiration haletante et de nos cris désespérés, celle qui nie la réalité qu’on nous enjoint d’accepter et, à la place, impose la manière de se rapporter au monde qu’on désire incarner. La guerre sociale est un deuil vécu individuellement, mais exprimé publiquement de façon à rendre possible une expérience collective de notre chagrin. La veillée devient une émeute. Celleux qui crient d’angoisse se mettent à hurler de rage. Celleux à qui on impose la souffrance comme une conséquence du fonctionnement du monde existant la renvoient à ce monde-là avec des objectifs destructeurs.
Mais la douleur aiguë ne peut soutenir très longtemps cette façon de se positionner. Autant que les vagues de l’émotion se succèdent et retombent, retrouvant forcément un équilibre en-dessous d’un certain seuil prédéfini, notre volonté de rejeter ce monde peut tout aussi bien retomber. La plupart des gens s’autorisent seulement d’incarner le deuil lorsque les circonstances extérieures les poussent tellement loin que cela va bien au-delà de ce que leur esprit est capable d’encaisser : un-e parent qui perd son enfant, un-e amant-e qui perd sa-on partenaire, un-e ami-e qui perd un-e camarade, pour ne citer que quelques exemples. Pour celleux d’entre nous qui souhaitons voir la guerre sociale s’étendre, se maintenir et gagner toujours plus de terrain avec chaque nouveau moment insurrectionnel, nous devons trouver un moyen d’ouvrir des espaces nous permettant de faire grandir notre détermination à plonger dans le deuil de façon intentionnelle. Nous devons alors cultiver une forme d’antagonisme généralisé.
Afin de puiser plus facilement dans notre chagrin pour que notre souffrance nous permette d’infliger des coups significatifs aux structures qui l’ont produit, nous devons articuler les causes de cette souffrance. Nous devons devenir capables de nommer nos ennemis et d’analyser explicitement la douleur qu’ils ont causée. Une articulation précise et sérieuse de l’expérience que nous faisons du monde et de notre capacité à l’impacter est plus facile à décréter qu’à produire, car elle demande un entraînement régulier. Elle exige d’être prêt-e à s’asseoir dans son insécurité et incertitude.
Elle exige de nous de pouvoir parler sincèrement et ouvertement avec celleux qui sont elleux-mêmes déterminé-es à parler avec sérieux, sans rentrer dans des jeux de postures, ni de se donner des airs d’importance superflus. Nous devons nous apporter mutuellement la confiance nécessaire pour parler avec certitude de notre expérience individuelle du monde, tout en nous encourageant à faire preuve d’humilité pour reconnaître que celle-ci est forcément limitée, car intrinsèquement subjective. Nous devons parler sincèrement et fermement de la manière dont ce monde nous assassine, mais nous devons le faire avec soin.
Plus nous apprenons à articuler les sources de notre souffrance et le chagrin qui en découle, plus nous devenons en mesure d’agir contre les machines de mort. Nous devenons plus conscient-es de leur présence au sein de notre quotidien, ainsi que de la manière dont ce quotidien sert à leur reproduction. Nous gagnons en discernement des actes capables de concrètement mettre en péril la reproduction de ces machines, que ce soit à travers des actions clandestines, ou – ce qui est plus important – un positionnement quotidien. Notre deuil devient une ressource dans laquelle on peut puiser, qui nous rappelle pourquoi on dit “nique la police” à chaque fois que sa présence commence à se faire sentir. Nous nous rappelons que vivre entièrement attaché-e à la logique d’auto-préservation équivaut à vivre déjà mort-e, et que vivre vraiment consiste à lutter pour une vie au sens large et non pas pour la simple survie.
A travers notre capacité à s’entraider à articuler nos souffrances, nous nous aidons aussi mutuellement à agir. En s’entraidant les un-es les autres à agir nous montrons à celleux qui nous entourent la possibilité de quelque chose de différent, autre que ce qu’il existe actuellement. Lorsque nous faisons notre deuil publiquement, pleinement et sans aucune retenue, nous invitons aussi les autres à faire pareil. Chaque acte de résistance plante les graines de sa propre reproduction. Lorsque que nous faisons de la résistance une part de notre quotidien, nous semons la reproduction d’une vie de résistance quotidienne.
Un-e ami-e m’a raconté une fois l’impact qu’avait eu sur ellui le fait d’observer pour la première fois un caillou lancé contre une fenêtre de prison. Iel m’a décrit comment ce moment-là lui avait permis d’accéder à un langage ouvrant une nouvelle façon de s’exprimer qu’iel ne connaissait pas avant. En étant témoin de la façon dont quelqu’un-e d’autre articulait succinctement son chagrin et ses désirs à travers la parabole tracée par le caillou, iel a gagné en capacité d’articuler plus sincèrement ses propres désirs. La guerre sociale se répand et, en ce faisant, elle nous ouvre la possibilité de véritablement se voir et se trouver.
IV. Trouve-moi dans l’ouragan
Je voudrais me réveiller demain
sans me rappeler de ton existence
je voudrais me réveiller demain
En fin de compte, chacun-e d’entre nous est tout-e seul-e dans ce monde. Il existera toujours un fossé entre notre expérience de la nuance et de la complexité de notre souffrance, et notre capacité à l’exprimer et la faire comprendre à l’autre. Nous nous sentons isolé-es. Nous serrons nos gorges de nos mains pour faire des sons et nous griffons les oreilles des autres pour être entendu-es, tout en se cachant derrière des métaphores et des euphémismes par crainte d’exposer nos propres insécurités. Dans un monde aussi cruel, aussi délibérément bâti sur la souffrance des gens vulnérables et marginaux, la réaction logique est de se détacher et de dissocier, de s’endurcir contre tout ce qui pourrait nous rendre vulnérables à notre tour.
Faire le deuil ouvertement et volontairement, c’est refuser ce jeu, ce spectacle, cette choréographie sans âme. C’est se rendre vulnérable contre toute logique d’auto-préservation. C’est hurler, non pas pour être entendu-e, mais en espérant que le sol tremble sous nos pieds. C’est planter ses griffes, non pas en quête de reconnaissance, mais pour faire saigner le monde qui t’a laissé-e battu-e et ensanglanté-e. C’est vivre, tel-le qu’on est, sans masque et sans déni d’à quel point cette existence est merdique. C’est forcer à s’ouvrir les mâchoires des machines de mort, et, avec ses poings et caillous, son sang et ses larmes, n’exiger rien de moins qu’une vie qui mérite d’être vécue pour soi-même et tou-tes celleux qui nous entourent.
S’il s’agit de se trouver afin de créer la possibilité d’un monde au-delà de celui-ci, composé de la mort et de la mort seulement, si nous désirons vivre par-delà la survie, nous devons véritablement nous rencontrer les un-es les autres. Nous devons trouver une voie pour incarner pleinement le deuil qu’on porte et, en ce faisant, encourager les autres à faire de même. On doit porter les autres et se laisser porter en retour. Se trouver l’un-e l’autre, c’est craquer cette dichotomie entre être “seul-e” et “ensemble”, de faire de ces mots des synonymes, de reconnaître que nous sommes toujours les deux à la fois.
Nous devons chialer seul-es, ensemble
Nous devons hurler seul-es, ensemble.
Nous devons nous débattre seul-es, ensemble.
Nous devons lutter seul-es, ensemble.
Nous devons brûler seul-es, ensemble.
Lorsque tu résistes aux machines de mort, peu importe la hauteur des ombres autour de toi, peu importe à quel point tu te sens loin des autres, tu peux être seul-e, mais tu es aussi ensemble avec tou-tes celleux d’entre nous qui résistons. Lorsque tu lèves ton pavé contre les flics lors d’une émeute ou sur une barricade ou seul-e dans une allée, tu le fais ensemble avec tout-es celleux d’entre nous qui avons déjà goûté à la violence de l’État et qui refusons d’accepter sa permanence présumée. Lorsque tu portes des coups à la forme-marchandise à travers le vol, le sabotage ou le refus de travailler, tu le fais ensemble avec tou-tes celleux qui refusent de lubrifier les pièces de ce projet écodiaire et génocidaire. Chaque action que tu entreprends pour articuler et lutter pour le monde que tu souhaites voir advenir est faite de concert avec tou-tes celleux qui désirent quelque chose de similaire. Tu es seul-e, mais vous êtes ensemble.
Même quand tu te sens faible, lorsque le deuil devient encore une fois un poids plutôt qu’une arme et que tout ça est trop lourd à porter, que les murs se referment sur toi de tous les côtés, lorsque survivre jusqu’à voir le prochain lever de soleil paraît aussi peu probable que de réaliser les mondes qu’on porte dans nos coeurs, tu peux bien être seul-e, mais tu es aussi avec tout-tes celleux d’entre nous qui restons éveillé-es, incertain-es de voir venir l’aube. Et si tu choisis de partir, en silence ou en feu, tu le fais seul-e, mais ensemble avec tou-tes celleux qui ont touché le fond du baril de ce monde de merde et qui l’ont rejeté avec l’entièreté de leur être. Aucun-e d’entre nous ne s’en sort vivant-e, et il peut y avoir une profonde (même si ultime) reconquête du pouvoir dans le fait de dicter les termes de ton départ. Mais sache que, égoïstement, j’espère que tu vas traîner dans les parages un petit peu plus longtemps.
Je ne vais pas te vendre une quelconque vision d’espoir ou affirmer qu’il suffit de tenir encore quelques années, ou mois, ou minutes de plus pour voir la fin de ta souffrance apparaître à l’horizon. Je n’ai aucune envie de te vendre quoi que ce soit ni de te dicter comment tu devrais ou ne devrais pas te rapporter à ta vie. Mais je vais te dire qu’il reste encore du sens à trouver ici-bas si tu le souhaites, mais c’est à toi de vouloir le trouver, et il reste aussi de la beauté ici-même. C’est une belle chose que de lutter pour une vie valant la peine d’être vécue, alors même que la logique et la rationalité de la cruauté de ce monde cherchent à saper notre force de lutter. C’est une belle chose de rejeter un monde construit sur la souffrance d’autant de gens, un monde construit sur ta propre souffrance. C’est une belle chose d’aider les autres à manier leur deuil comme une arme, d’articuler leurs désirs, de trouver une volonté de lutter. C’est à toi de créer du sens.
Peu importe où tu te trouves, ou qui tu es, sache que si tu agis avec intention et désir de voir la fin de ce monde de machines de mort, j’agis avec toi. Pour chaque coup que tu donnes contre les institutions de nos souffrances, je me réjouis avec toi. Pour chaque coup que tu prends, chaque fois que tu te cognes la tête contre le béton et que tu es amené-e à goûter ton propre sang, j’enrage avec toi. Et lorsque je manie mon deuil comme une arme, comme un couteau à la gorge de ce monde infernal, je le fais en te gardant dans mon coeur. Peut-être que nous ne nous croiserons ni ne nous rencontrerons jamais, mais nous luttons ensemble, tout en luttant seul-es.
Sache-le.